Penser l’effondrement : entretien avec Pierre-Yves Longaretti et Emmanuel Prados
Société
Article
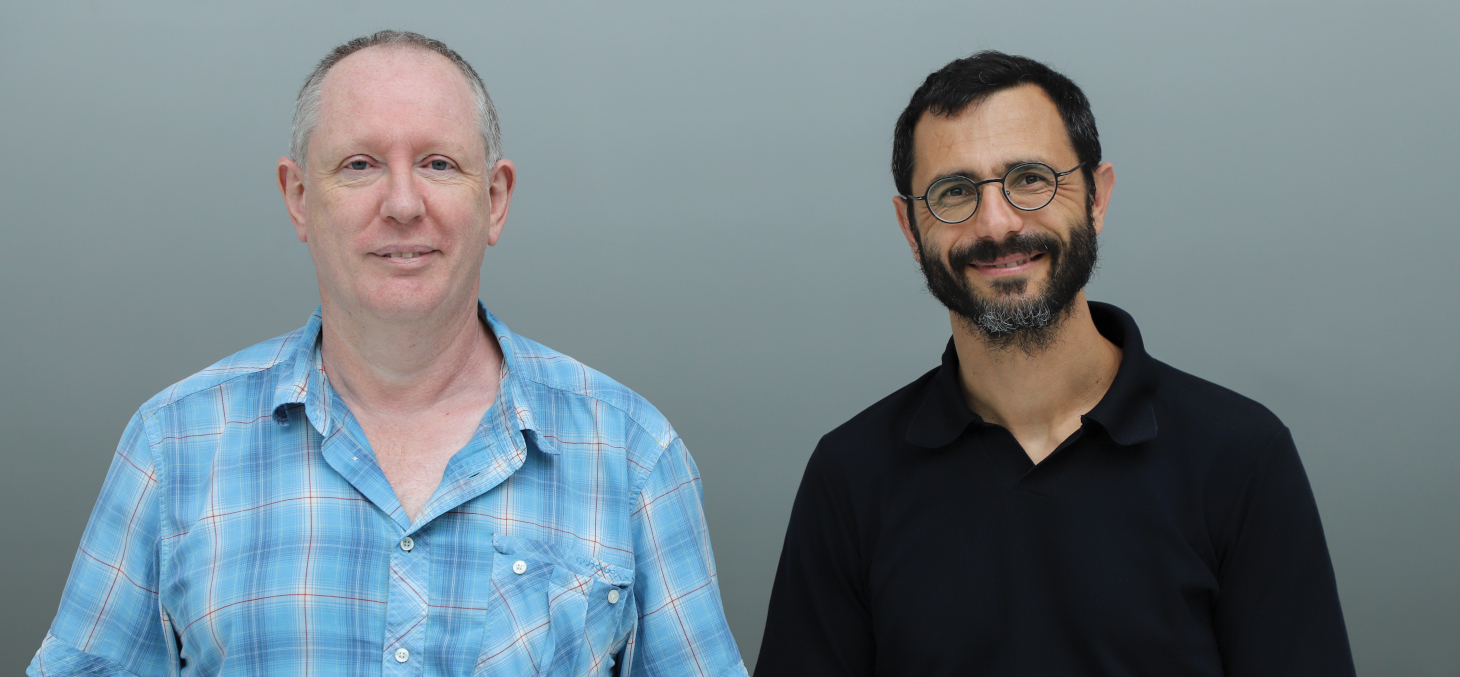
Pierre-Yves Longaretti et Emmanuel Prados font partie de l'équipe STEEP (Soutenabilité, Territoires, Environnement, Économie et Politique) qu'ils ont co-fondée à Inria Grenoble Rhône-Alpes. Il y a quelques années, le premier était encore astrophysicien, le second spécialiste de la vision par ordinateur. Désormais, tous les deux ont choisi de se consacrer aux questions de transitions et d'effondrements. Découvrez leur entretien réalisé il y a quelques mois, avec en bonus un podcast (H)auteurs pour aller plus loin et mettre en perspective l'effondrement dans le contexte de la crise du Covid-19.
Podcast (H)auteurs : Penser l’effondrement, la crise du Covid en perspective
La crise du Covid est-elle un pas de plus vers l’effondrement ? Pierre-Yves Longaretti, chercheur à l’IPAG (UGA / CNRS / Inria), revient sur les crises passées et actuelles, et la perception de l’effondrement dans la société.On entend souvent parler de "collapsologie" pour désigner l'étude des effondrements. Est-ce un terme que vous utilisez ?
Pierre-Yves Longaretti : Non, pas du tout. La collapsologie n'est ni une discipline scientifique, ni une mouvance très claire…Emmanuel Prados : C'est juste un mot à la mode, très pratique pour communiquer. Mais derrière, il y a trop d'affirmations imprécises, voire fausses, sans parler des discours partisans. Du coup, nous ne pouvons pas nous identifier à cela. Maintenant, le mot mis à part, la problématique de l'effondrement est une vraie question.
P.-Y.L. : Nous estimons qu'il est de notre responsabilité de chercheurs de voir ce qui peut être dit de scientifiquement solide sur cette question. Nous avons un programme de recherche sur ces problématiques, sur la robustesse et la validation de ce qui est lié à ce sujet.
Le risque d'effondrement est-il réel pour nos sociétés modernes ?
P.-Y.L. : Le discours d'effondrement qui domine actuellement est celui issu du Club de Rome à l'origine du Rapport Meadows en 1972. Dans le scénario standard, ils prévoyaient que si nous ne changions rien à nos modes de vie et de production, nous allions vers un effondrement par dépassement de capacité et érosion de la biocapacité[1]. Ce qui était de l'ordre de la projection en 1970 est la réalité aujourd'hui : depuis les années 80, nous consommons les ressources renouvelables beaucoup plus vite qu'elles ne se renouvellent.Mais il y a aussi d'autres problématiques d'effondrement auxquelles nous pouvons être confrontés, liées à des instabilités du système global d'approvisionnement, qu'il soit énergétique ou de matières premières alimentaires, aux instabilités financières, etc.
EP : La description qualitative des processus d'effondrement est assez robuste ; la quantification, elle, est plus difficile. Sur la partie biogéophysique, nous avons des mesures, des indicateurs, il y a moins d'incertitude. Mais il est difficile de savoir et de quantifier comment ces stress vont se répercuter sur la partie structurelle de la société. Il est difficile de prévoir ce qu'il va se passer au niveau économique, géopolitique, etc. La forme, l'amplitude, le temps que l'effondrement va prendre sont très incertains.
P.-Y.L. : Quoi qu'il en soit, nous sommes partis pour un effondrement, c'est sûr. Le dépassement de capacité et l'érosion de la biocapacité ne sont pas forcément les menaces les plus grandes, mais elles sont très sérieuses et certaines.
La question n'est donc plus de savoir "si" mais "comment" et "quand" ?
Quand on a accepté l'idée d'un effondrement, la question qui vient ensuite est celle de la gestion de la transition.
EP : Et puis, est-ce que l'on sera capable d'agir avant ?
P.-Y.L. : Pour le moment, il est évident que nous sommes en retard de réaction. Cela fait 30 ans que l'on discute de limiter les émissions de gaz à effet de serre et leur rythme ne fait que s'accélérer. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation qui n'a pas d'équivalent dans le passé, simplement parce que les problématiques sont à l'échelle globale et sur tous les fronts, environnementaux et sociétaux.
EP : Il y a différents processus à l'œuvre en parallèle, certains à long terme, comme l'érosion de la biocapacité, et d'autres à court terme, plus aléatoires liés à l'organisation de nos sociétés. Les dynamiques peuvent être différentes avec des mécanismes de dépassement de seuil ou des mécanismes de contagion provoquant un effet domino par exemple.
P.-Y. L. : Dans les scénarii envisagés, un effet domino majeur qui ferait tout s'effondrer d'un coup est peu probable. En revanche, une succession d'effets domino qui causerait un effondrement graduel est vraiment possible. D'un certain point de vue, la crise économique de 2008 en est une illustration. On pourrait considérer qu'il ne s'est pas passé grand-chose puisque la crise a été maitrisée tout de suite. Sauf que les conséquences se font encore ressentir : il y a plus de pauvreté, plus de chômage et plus d'endettement des États occidentaux. Est-ce que l'on a fait quelque chose pour corriger le système bancaire et financier ? Non. On a tout fait pour le sauvegarder, le faire revenir à son état antérieur. Donc, il n'y a pas de raison que ce genre de crise ne se reproduise pas.
Pourquoi cette inertie alors que le risque est connu depuis des décennies ?
La réaction la plus fréquente face à un problème pour lequel on ne voit pas de solution est de nier le problème...
P.-Y. L. : Imaginer qu'augmenter la connaissance scientifique suffit à créer la bonne réaction est une illusion totale. La réaction la plus fréquente face à un problème pour lequel on ne voit pas de solution est de nier le problème…
EP : Et puis, c'est une prise de conscience douloureuse. Personnellement, alors que j'étudiais ces questions, au début, je ne pouvais pas accepter l'idée d'un effondrement. Cela était pour moi inconcevable. Pendant de longs mois, j'ai eu physiquement mal au ventre. Ça m'a pris du temps pour digérer l'idée. J'ai encore parfois des pics de stress, surtout quand je lis la presse…
P.-Y. L. : Oui, presque tous les mois, on peut lire que finalement la situation est pire que ce que l'on pensait : les émissions de méthane sont beaucoup plus importantes que prévues, la fonte des glaces arctiques plus rapide, le taux de désertification, l'acidification des océans, la perte de biodiversité, etc.
EP : Même si l'on imaginait tout cela, le fait de le voir devenir réel… On préférerait avoir tort… Mais quand on a accepté l'idée d'un effondrement, la question qui vient naturellement ensuite est celle de la gestion de la transition.
Et comment va se passer la transition ?
EP : Si on admet que le scénario le plus probable est celui d'un effondrement graduel, dans la succession de chocs, certains d'entre eux vont nous contraindre à changer les choses. Peut-être pas suffisamment pour arrêter l'effondrement, mais au moins le ralentir. Et l’amplitude de certains chocs va nous obliger à faire sauter des verrous qui paraissent aujourd’hui immuables : la logique de croissance économique dans laquelle nous sommes enfermés par exemple. Nous ne pouvons pas en sortir car nous maintenons le système pour ne pas tomber. Mais le jour où il y aura une crise économique extrême, nous pourrons peut-être changer de modèle, et remettre à zéro les dettes, les monnaies, etc.P.-Y. L. : En tant que chercheur, ce que nous essayons de faire, c'est évaluer les scénarii possibles et leurs probabilités. Les marges d'incertitude sont grandes mais notre objectif est de mettre ces informations sur la table. Après, ce sont des choix sociétaux et politiques.
A-t-on encore des marges de manœuvre ? Que peut-on faire ?
Ce ne sera pas la fin du monde mais la fin d'un monde.
EP : Dans l'hypothèse d'un effondrement graduel, la transition peut durer quelques décennies, voire un siècle. Des possibilités d'action pourront apparaître. Mais pour arriver à les percevoir, il faut avoir une compréhension globale des risques systémiques.
P.-Y. L. : Rester dans un flou psychologique est complètement paralysant. La première chose à faire est donc de s'informer, car les problèmes sont complexes. À titre individuel, il est important de se les approprier pour mesurer leur ampleur et voir comment agir. Mais agir ne veut pas forcément dire être capable de résoudre tous les problèmes. On ne peut pas être sur tous les fronts. Il faut comprendre le système global et choisir un combat.
EP : Décider de s'isoler pour essayer de vivre de façon autonome, c'est une erreur. Il est plus pertinent d'agir à l'échelle territoriale pour mettre en place des actions qui en renforcent la résilience. Clairement, il est à notre portée de nous réunir en collectifs et de décider de créer à l'échelle d'un territoire, une centrale photovoltaïque ou une monnaie locale par exemple. On pourrait discuter de la pertinence de ces projets mais ce genre d'action est à la portée de collectifs de citoyens.
PYL : Et ils ne sont pas anecdotiques. Actuellement, une monnaie locale ne peut pas avoir des règles monétaires différentes, la contrainte législative est un verrou trop fort. Néanmoins avoir créé sur un territoire l'infrastructure pour son fonctionnement est un atout évident pour la faire fonctionner à plein le jour où c'est possible… et surtout le jour où cela devient nécessaire.
EP : Au final, ce ne sera pas la fin du monde mais la fin d'un monde…
Même si les problèmes sont mondiaux, est-il vraiment possible d'agir à l'échelle individuelle ?
PYL : Comme le faisait remarquer Dennis Meadows, il faut distinguer les problèmes globaux des problèmes universels. Le changement climatique est un problème global. Qu'est-ce que je peux faire à titre individuel contre ça ? Je peux prendre moins ma voiture, moins l'avion, manger moins de viande, etc. mais est-ce que je vais infléchir la courbe ? Non. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire non plus ! Mais à un problème global, il faut une réponse globale, c’est-à-dire une coordination à très vaste échelle pour arriver à faire quelque chose.Meadows préconise de se préoccuper individuellement ou en petit collectif plutôt des problèmes universels, c'est-à-dire des problèmes qui se posent partout et sur lesquels nous pouvons agir localement, comme la gestion de l'eau ou l'étalement urbain, par exemple. Par contrecoup, cela peut avoir une influence à l'échelle globale soit en tant que levier politique soit par la valeur d’exemple.
De plus, c'est vrai qu'à titre individuel, les problèmes peuvent sembler absolument monstrueux, mais quand on les chiffre, à titre collectif, ils seraient tout à fait gérables. La restauration des écosystèmes - dans la limite du possible - coûterait de 100 à 200 milliards de dollars par an, idem pour l'éradication de la pauvreté, de la faim dans le Monde, pour la généralisation des soins médicaux et de l'éducation de base. À l'échelle de la planète, ce n'est rien ! Le budget américain, c'est 3000 milliards de dollars par an. Leur budget militaire, c'est entre 700 et 800 milliards de dollars annuels. Le tiers du budget militaire américain suffirait à attaquer de façon extrêmement efficace ces problèmes. Mais le constat est là : rien n’est fait ou presque, en tout cas rien de significatif à l’échelle du problème. C'est donc que le problème est politique. Il n'est ni économique, ni technologique…
Que sera le monde d'après ?
EP : Les gens qui parlent de collapsologie accordent beaucoup d'importance à l'après. Mais c'est souvent parce qu'ils sont dans un imaginaire de rupture. Ils pensent que tout va s'effondrer brutalement et qu'il faudra reconstruire quelque chose. Ils pensent qu'ils vivront un "avant" et un "après". La question pour nous n'est pas d'imaginer ce qu'il y aura après. La vraie question est comment on gère la transition. Les gens qui resteront, gèreront comme ils pourront.PYL : Il y a des imaginaires naïfs, comme celui d'une société agraire qui serait une sorte de retour en arrière. Mais pour moi, cela n'a aucun sens. Pourquoi ? Parce que le régime climatique sera complètement différent. On ne pourra pas reproduire l'agriculture du 19e siècle au 23e siècle, ni même au 21e siècle avec les changements climatiques qui se préparent. Un problème similaire se pose pour la question de la restauration des écosystèmes : l’essentiel des pertes passées et à venir est irréversible ou impossible à prévenir, ne serait-ce qu’en raison du changement climatique et bien qu’on puisse en minimiser les effets...
Concernant l’agriculture, la seule chose à peu près certaine est que les étés seront secs car il n'y aura plus de glaciers à terme. Or c'est un problème critique pour la moitié de l'Humanité car une part importante de l'irrigation se fait aujourd'hui par pompage des fleuves en été, fleuves qui sont encore alimentés par la fonte de glaciers qui se reconstituent en hiver. Le jour où il n'y a plus de glaciers, c'est fini. On peut bien sûr avoir des formes de culture dans des zones semi-désertiques mais elles ne permettent pas de nourri des populations très importantes. On peut éventuellement vivre sur une planète semi-désertique ; la question, c'est à combien de personnes…
EP : Voilà… Alors comment va-t-on passer de 7,5 milliards d'individus sur Terre à 4, peut-être 2 milliards ? Ce passage d'un monde à l'autre ne se fera sûrement pas en douceur.
Note
[1] Capacité des écosystèmes d'une région donnée à produire de la matière biologique (ressources renouvelables) et à absorber les déchets générés par les sociétés humaines.
[1] Capacité des écosystèmes d'une région donnée à produire de la matière biologique (ressources renouvelables) et à absorber les déchets générés par les sociétés humaines.
Publié le6 octobre 2020
Mis à jour le6 octobre 2020
Mis à jour le6 octobre 2020
Vous aimerez peut-être aussi
- The Conversation : "Avec la guerre, changement d’ère dans la géopolitique du climat ?"
- The Conversation : "Dépenses, manque de transparence… pourquoi le recours aux cabinets de conseil est si impopulaire ?"
- The Conversation : "Et pourtant, on en parle… un peu plus. L’environnement dans la campagne présidentielle 2022"
- The Conversation : "L’empreinte carbone, un indicateur à utiliser avec discernement"
Pour aller plus loin
Pierre-Yves Longaretti est l'auteur de la traduction du livre de Lester R. Brown Le plan B : pour un pacte écologique mondial (Calmann-Lévy, Souffle Court Éditions), une synthèse claire et impitoyable des connaissances sur le risque d’effondrement.
Depuis 2015, Emmanuel Prados et Pierre-Yves Longaretti animent le cycle de conférences-débats "Comprendre et Agir" autour des questions de soutenabilité.
Ces conférences sont filmées et les vidéos accessibles en ligne.
Depuis 2015, Emmanuel Prados et Pierre-Yves Longaretti animent le cycle de conférences-débats "Comprendre et Agir" autour des questions de soutenabilité.
Ces conférences sont filmées et les vidéos accessibles en ligne.

Podcast (H)auteurs
1 jour, 1 podcast - Fête de la science 2020
Chaque jour, un ou une scientifique de l’Université Grenoble Alpes nous raconte ses recherches en podcast. Actualités scientifiques, expériences, innovations, anecdotes…
Découvrez en audio l’envers du décor de la recherche à Grenoble !
Chaque jour, un ou une scientifique de l’Université Grenoble Alpes nous raconte ses recherches en podcast. Actualités scientifiques, expériences, innovations, anecdotes…
Découvrez en audio l’envers du décor de la recherche à Grenoble !

